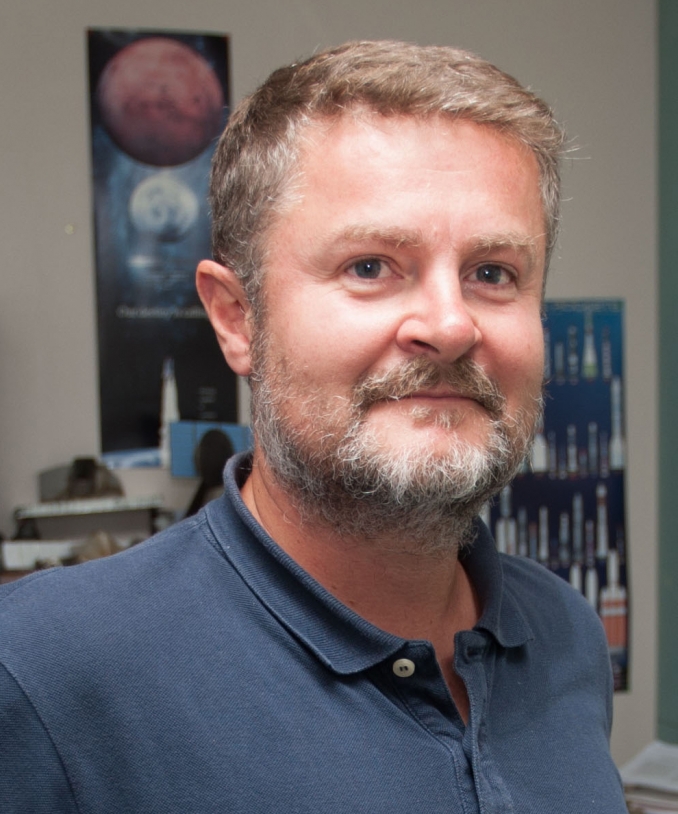Représentation d'artiste des débris en orbite basse. Leur taille est délibérément exagérée. Crédits : ESA.
60 D'UN COUP !
Le 24 mai 2019, SpaceX a lancé les 60 premiers satellites de sa constellation Starlink destinée à fournir Internet à la planète entière depuis l’espace. Selon les communiqués, ce service sera opérationnel à partir de 800 engins positionnés à 550 km d’altitude. Mais pour assurer leur renouvellement, c’est 12 000 satellites de 227 kg que l’entreprise d’Elon Musk prévoit de lancer d’ici à 2027. Oui, vous avez bien lu : 12 000 satellites ! Pour donner un ordre de grandeur, il y a actuellement 2 000 satellites actifs en orbite autour de la Terre et 34 000 objets de taille supérieure à 10 cm : satellites hors services, étages de fusées abandonnées, morceaux de protection thermique, panneaux solaires,…
Starlink n’est pas le seul projet de méga-constellation dans les tuyaux spatiaux. Avec le même objectif, la startup OneWeb prévoit d'envoyer 650 satellites à 1 200 km d’altitude d’ici à 2021. Ses engins sont actuellement en cours d'assemblage chez Airbus à Toulouse. Quant à Amazon, son fondateur, Jeff Bezos, parle de lancer 3 200 satellites entre 590 et 630 km d’altitude. Ce nombre incroyable de satellites ne prend pas en compte les petits satellites (cubesats, pico-sats, chip sats) dont les lancements s’accroissent année après année. L’ESA, l'agence spatiale européenne, a d'ailleurs dévoilé un déployeur pour 41 satellites (dont 35 cubesats) pour sa fusée Vega, avec un 1er test en septembre 2019.
L’espace va-t-il devenir encombré ? Va-t-il falloir jouer à « Crossy Road » dans une version orbitale avant de réaliser des lancements ? D’une certaine manière, oui. Trouver un créneau de tir sûr va s’avérer plus difficile. Certains pointent d’ailleurs la nécessité d’établir un plan de circulation de l'espace et l'essor d'un métier celui de « space traffic controller», contrôleur du traffic spatial. Mais les méga-constellations représentent surtout un défi dans la gestion des satellites afin qu'ils ne compromettent pas une utilisation durable de l’espace autour de la Terre.
Train de satellites Starlink. Une quarantaine sont visibles sur cette photo. Crédits : SatTrackBlog/Marco Langbroek.
Starlink will connect the globe with reliable and affordable high-speed broadband services pic.twitter.com/dWVvPwVWU4
— SpaceX (@SpaceX) May 24, 2019
RANGE TON ESPACE
Des directives internationales issues des travaux de l’IADC donnent des « guidelines » ou recommandations afin d’avoir une utilisation durable de l’espace. Ces recommandations – non contraignantes – stipulent qu’un satellite en fin de vie doit :
- vider ses réservoirs en carburants et passiver ses batteries afin d’éviter tout risque d’explosion,
- débarrasser son orbite dans les 25 ans qui suivent la fin de sa mission si le satellite se trouve en orbite basse (altitude < 2 000 km)
- sortir de la zone protégée géostationnaire et ne pas la recroiser avant 100 ans si le satellite était en mission à 36 000 km altitude.
« Pour les satellites en orbite basse, cela veut dire réaliser les manœuvres pour descendre en altitude et venir se consumer dans l’atmosphère. Pour les satellites en orbite géostationnaire, c’est se mettre sur une orbite dite cimetière située à plus de 300 km de l’altitude géostationnaire ou au-delà de +/- 15° d’inclination par rapport à l’équateur » indique Pierre Omaly, expert en sécurité des vols spatiaux au CNES. Mais limitation technique ou envie d’exploiter le satellite jusqu’à son dernier litre de carburant, ces recommandations ne sont respectées que dans 12% des cas en orbite basse et 70% en orbite géostationnaire.
En rouge, bleu et vert : les régions à protéger des débris spatiaux. La zone LEO (Low Earth Orbit) correspond aux orbites basses (<2 000 km). La région GEO (Geostationary Earth Orbit) correspondant à la zone des satellites géostationnaires située à 36 000 km d'altitude. Crédits : CNES.
ALLER AU-DELÀ
... des collisions ou explosions pourraient se produire et générer des débris qui peuvent monter en altitude jusqu'à plus de 1 000 km...
Bonne élève, la France a traduit en 2018 ces « guidelines » dans une une loi : la Loi relative aux opérations spatiales (LOS). Elle est le 1er pays à l'avoir fait et le seul à avoir une règlementation technique associée. Seuls les opérateurs de satellites français y sont soumis. « Les nouveaux acteurs tels SpaceX et OneWeb ont toutefois déclaré suivre ces recommandations et aller même au-delà. Le fait de garder un espace propre est nécessaire au succès de leur entreprise sur le moyen terme. Trop de satellites en panne et de débris peuvent aussi endommager leur constellation. Mais en 5-10 ans, il peut s’en passer des choses. L'avenir nous le dira » explique Pierre Omaly.
Positionnés à 550 km d’altitude, les satellites Starlink seront sous la zone avec le trafic le plus dense située entre 700 et 1 000 km. « A 550 km, des satellites avec les caractéristiques de Starlink retombent naturellement dans l’atmosphère en moins de 5 ans par frottements avec l’atmosphère résiduelle. Mais en raison d’un taux de panne qui pourrait ne pas être négligeable dans un 1er temps, des collisions ou explosions pourraient se produire et générer des débris qui peuvent monter en altitude jusqu'à plus de 1 000 km, traversant ainsi les zones les plus denses » indique Vincent Ruch, spécialiste en surveillance de l’espace au CNES.
Au CNES, on tente d'évaluer l'effet de l'introduction des méga-constellations sur l’environnement orbital. « Mais les conclusions de nos simulations dépendent beaucoup des hypothèses prises sur le taux de respect des procédures de fin de mission : passivation des batteries, vidage des réservoirs, amener le satellite sur une orbite qui va permettre sa rentrée ou la non interférence avec la région GEO » souligne l'expert.
Vers des étiquettes d'impact spatial ?
Les collisions et explosions sont la crainte principale des spécialistes car chacune peut générer des centaines voire des milliers de débris. Or, à des vitesses d’impact pouvant atteindre 50 000 km/h, même un débris d’1 cm peut endommager sévèrement un satellite, voire le transformer à son tour en un nuage de débris. Un satellite lancé aujourd’hui aurait ainsi 3 % de chances de finir prématurément sa vie à cause d’un impact d’un débris spatial. Chaque année, un satellite en orbite basse réalise en moyenne une manoeuvre anti-collision pour éviter un débris de plus de 10 cm.
Reste donc à trouver des solutions pour garantir la viabilité des activités spatiales à moyen et à long terme. Cela peut passer par la promotion de la norme ISO 24113 qui garantit que la conception, l'exploitation et l'élimination des engins spatiaux et des étages des lanceurs éjectés dans l’espace ne génèrent pas de débris durant leur séjour en orbite. Et pourquoi ne pas imaginer des étiquettes d’impact spatial telles celles d'impact environnemental et énergétique à coller sur les fusées et satellites ? Au CNES, et dans d’autres agences spatiales, on y réfléchit sérieusement...
Représentation d'artiste de 2 satellites Starlink. Crédits : SpaceX.
Voici à quoi pourraient ressembler les étiquettes d'impact spatial pour les fusées et satellites de demain. Crédits : CNES.